ENTRETIEN
Entretien réalisé par Frédéric DURAND et Franck VERHERBRUGGEN
— Le 26 juillet 2020, vous avez été nommée secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire. C’était pour vous une surprise? Vous venez de la droite libérale, or c’est un poste qui jusqu’ici était plutôt confié à des personnalités de gauche…
Olivia Grégoire : C’est signé Emmanuel Macron. C’est un transgressif, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je suis à ses côtés. C’est quelqu’un qui n’est pas là où vous l’attendez, je pense qu’il a aussi souhaité surprendre en mettant une femme plutôt libérale, issue du monde de l’entreprise, sur un écosystème très clairement identifié à gauche.
— On parle désormais d’économie sociale, solidaire et responsable. Vous teniez à rajouter « responsable » parce que vous pensiez qu’elle ne l’était pas suffisamment ?
OG : Elle l’était. Mais le « responsable » s’adresse davantage aux entreprises en général plutôt qu’aux structures sociales et solidaires qui ne m’ont pas attendue pour être responsables. J’ai deux grands axes dans mon périmètre : d’abord la mission de soutenir et d’accompagner l’économie sociale et solidaire (ESS), notamment pendant la crise (et nous avons démontré sa solidité), et en parallèle favoriser la responsabilisation du capitalisme. Mes journées sont rythmées par ces deux axes: d’une part, l’accompagnement et le soutien aux associations, coopératives, aux ESUS (Entreprises solidaires d’utilité sociale), aux fondations, aux mutuelles ; et d’autre part, le travail auprès des entreprises traditionnelles pour les engager de plus en plus sur la voie de la responsabilité. Cela passe notamment par la pédagogie et la réglementation sur l’ESG, c’est-à- dire la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.
— Ces deux secteurs sont-ils complètement dissociés ? Ou est-ce que vous essayez de promouvoir dans le système de l’ESS la notion de rentabilité?
OG : Je parlerais davantage de « performance » plutôt que de rentabilité. Être une entreprise de l’économie sociale et solidaire, à lucrativité limitée, n’empêche pas d’obtenir de bons résultats. Je donne souvent l’exemple de l’ESUS Phenix, qui récupère des produits alimentaires invendus pour lesconfier à des associations et éviter qu’ils ne soient jetés. L’idée est excellente, mais en plus, cette idée s’accompagne d’un modèle économique parce que les entreprises qui donnent leurs produits payent un service à Phenix. En septembre 2020, en pleine crise, ils ont recruté une dizaine de personnes en CDI sur toute la France avec une performance économique et des résultats qui étaient 100 % supérieurs à ceux de 2019. Ce sont des entreprises ESUS mais elles ont les mêmes bilans comptables et un fonctionnement identique à celui des petites et moyennes entreprises (PME) classiques.
Mon but est de créer des ponts entre les deux écosystèmes : l’ESS et les entreprises dites plus traditionnelles.
Ces dernières ont d’ailleurs beaucoup à apprendre des pratiques de l’économie sociale et solidaire, notamment en matière de partage de pouvoir ou de partage de la valeur.
— Votre immersion dans l’économie sociale a-t-elle modifié la vision que vous en aviez jusqu’alors ?
OG : Oui, je viens de l’entreprise classique et je crois qu’il est urgent de faire évoluer le capitalisme tel que mes parents et grands-parents l’ont connu. C’est ce que je tente d’expliquer dans mon ouvrage Et après ? Pour un capitalisme citoyen. Je promeus dans ce livre un modèle capitaliste dans lequel je crois, et qui, pour paraphraser Churchill, est selon moi « le pire des régimes à l’exception de tous les autres « . Je crois en un capitalisme utile en matière de diffusion du progrès à l’échelle de la planète, du progrès scientifique et même du progrès social. Mais il faut le rénover et, pour cela, faire davantage confiance aux citoyens. Je crois à l’intelligence citoyenne et j’estime qu’il est très important que l’on donne plus d’informations et donc qu’il y ait plus de transparence de la part des entreprises sur leurs pratiques. Je ne pense pas seulement aux pratiques financières mais surtout aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Le grand enjeu qui est devant nous, c’est celui d’un libre arbitre éclairé : il est indispensable de donner les informations nécessaires aux citoyens-salariés, aux citoyens-épargnants et aux citoyens-consommateurs pour qu’ils puissent faire leurs choix en conscience… Je suis vent debout contre les tentations de certains à vouloir choisir à la place des gens. Quand vous achetez une machine à laver, vous avez un code couleur qui vous permet de voir le caractère énergivore ou non de l’appareil, idem sur les voitures, et de plus en plus sur les produits alimentaires avec le Nutriscore. Le Nutriscore correspond d’ailleurs exactement à ce que je pense être dans les pratiques à promouvoir d’un capitalisme plus citoyen, c’est-à-dire donner plus d’informations vérifiées sur la nature des biens, des produits et des services pour que le citoyen puisse décider lui-même. J’estime que ce n’est pas le rôle de l’État de tout autoriser ou interdire à l’aune de la morale : c’est aussi prendre les gens pour des imbéciles, parce qu’il suffit d’aller à Bruxelles, à Liège ou à Düsseldorf et de revenir avec la voiture qui serait pourtant interdite en France. L’instauration d’une vignette Crit’Air telle que mise en place avec Bruno Le Maire et Barbara Pompili me paraît plus pertinente. Décider à la place de nos concitoyens de ce qui serait bon ou non est une tendance que je trouve dangereuse, parce qu’infantilisante, et même insultante à l’endroit de leur libre arbitre.
— En même temps, ne faut-il pas être plus exigeant avec les entreprises ?
OG : La transparence est une exigence. Je me bats sur le plan économique, et l’Europe se bat aussi, pour que les entreprises dans les années qui viennent donnent à voir de plus en plus leurs pratiques, non seulement financières mais aussi extrafinancières, sur le plan environnemental, social, et de gouvernance. Cette performance extrafinancière est portée par une directive européenne qui s’appelle CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Elle impliquera une nouvelle comptabilité qui va devenir obligatoire à compter de 2024 dans tous les pays de l’Union européenne pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés.
— Il s’agit d’inclure au bilan la soutenabilité environnementale et sociale de l’activité?
OG : Oui, les entreprises vont être obligées de publier leurs données de performance non plus seulement financières, mais globales. Quel est votre bilan carbone ? Avez-vous un plan de mobilité interne avec des véhicules électriques? Qu’est-ce que vous faites en matière de production et d’éco conception de vos produits? Existe-t-il des primes d’intéressement, de participation ? Y a-t-il des dispositifs d’épargne salariale ? Quel est le traitement des personnes en situation de handicap, l’intégration des salariés issus de minorités ? Combien de femmes dans les organes dirigeants ? Nous connaîtrons également les écarts de rémunérations entre les dirigeants et les plus bas salaires de l’entreprise. Au même titre que les entreprises ont un bilan financier avec des indicateurs financiers précis, elles auront un bilan extra-financier avec des indicateurs précis et harmonisés. Ensemble, ces deux bases constitueront la performance globale de l’entreprise. Il y a d’ailleurs déjà des agences de notation extrafinancière.
—Si cette agence sanctionne les entreprises, cela aura-t-il un impact réel — faire baisser le cours de l’action en bourse, par exemple ?
OG : On y arrive… Le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a été promulgué en mars. L’avantage du règlement c’est l’exécution immédiate : les investisseurs, donc les banques et les acteurs de l’investissement du private equity, vont devoir « soulever le capot » dans les années qui viennent et donner à voir la performance extrafinancière des actifs qu’ils ont sous gestion. Par exemple, si une entreprise va voir sa banque et lui dit qu’elle veut une certaine somme pour se développer, alors la banque va s’intéresser à sa durabilité, c’est-à-dire aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et pas seulement au bilan comptable. Très prochainement, et l’entrée en vigueur de la CSRD y contribuera, les entreprises qui ont de très bons résultats financiers mais qui n’ont fait aucun progrès en matière « d’impact ESG » auront de vraies difficultés de financement.
— Même si les résultats financiers sont bons ?
OG : Oui, car si cette entreprise n’a pas, par exemple, de stratégie de décarbonation, le fonds d’investissement ou la banque ne voudront pas la financer. Quel sera l’intérêt d’un financeur d’aller financer une entreprise dont la performance extrafinancière fait baisser la sienne ? À l’inverse, une entreprise qui a un résultat financier en deçà des résultats escomptés mais qui a mis 100 % d’actionnariat salarié et une strate de décarbonation sera capable de lever des fonds malgré une performance financière un peu moins bonne. Il faut comprendre que c’est vraiment la conjonction de ces deux éléments qui dictera demain les arbitrages des investisseurs.
—Mais il est où le bâton? Le capitalisme tel qu’il est aujourd’hui n’a qu’une obsession, c’est le profit.
OG : Prenez l’exemple de Shell aux Pays-Bas : ils font des profits mais ils viennent de se faire condamner pour non-respect des engagements climatiques et absence de stratégie de décarbonation. Regardons aussi BlackRock qui commence à ne plus voter des résolutions d’actionnaires en l’absence de stratégie de décarbonation. C’est quoi, le bâton ? La fin de la rentabilité: l’entreprise ne trouvera pas de financeurs, elle aura des ruptures de charge dans ses investissements. Ce qui a changé aujourd’hui — et que l’on a écrit dans la loi Pacte — c’est : oui au profit, mais en prenant en compte l’impact environnemental et social de l’action des entreprises. L’objectif du capitalisme demeure de faire du profit, mais pas n’importe comment.
À cet égard, la crise que l’on vit a une spécificité au regard de l’histoire économique contemporaine. Chacune des crises précédentes (1929, 1973, 2007) tenait son origine d’une défaillance économique ou financière. Avec celle que nous traversons, c’est la première fois qu’une crise a pour fondement soit une atteinte profonde à la biodiversité, soit une erreur humaine, donc un sujet social. C’est donc la première fois que l’on subit une crise à impact financier et économique d’origine environnementale ou sociale. Les investisseurs intègrent désormais dans leur analyse de risque les scenarii de crash climatique. À tel risque financier, tel risque économique ou tel risque social s’ajoute désormais le risque de pénurie de matières premières, le risque « pangolin », et le risque d’erreur humaine.
— Est-ce que l’on peut dire que l’économie sociale et solidaire pourrait représenter un atout dans cette nouvelle économie ? Il y a un champ pour elle avec la prise en compte notamment pour les investisseurs de ces nouveaux critères ?
OG : L’ESS a énormément apporté au reste de l’économie avec des pratiques innovantes notamment sur le plan environnemental et social. C’est l’ADN de l’ESS qui depuis des siècles vit autour de trois fondamentaux : 1. lucrativité limitée ; 2. partage de la valeur ; 3. partage du pouvoir.
Ce sont ces fondamentaux dont je pense qu’ils peuvent et doivent polliniser le reste de l’économie. À l’inverse, le reste de l’économie a beaucoup à apprendre aussi à l’ESS, notamment en matière de passage à l’échelle. Longtemps, les structures de l’ESS ont été petites et avaient du mal à se regrouper, elles avaient une vision très locale, mais c’est en train de bouger, à la faveur de dispositifs que nous avons mis en place pour permettre de meilleurs financements et une meilleure coopération entre les parties prenantes. Nous ne sommes plus obligés de choisir : on peut être rentables, utiles et durables.
— Reprenons les trois points que vous venez d’évoquer: lucrativité limitée, partage de la valeur, partage du pouvoir. C’est le capitalisme de demain, ça ?
OG : J’en suis intimement convaincue : les entreprises vont toutes devoir accepter de diminuer leur rentabilité pour mieux prendre en compte leur impact, par exemple en faisant le choix de produire en France ou de mieux rémunérer leurs salariés. C’est le cœur de mon livre Et après ? Pour un capitalisme citoyen.
— Quel serait l’intérêt de partager le pouvoir en entreprise ?
OG : La question, c’est plutôt : quels risques prendrions-nous à ne pas le partager ? Aux États-Unis, il existe depuis très longtemps la règle des 3 P dans le business : People-Product–Profit. Et dans cet ordre, car la première richesse d’une entreprise ce sont ses salariés: si l’on n’a pas les salariés, on n’a ni la compétence, ni le savoir- faire, ni la compétitivité. On le voit dans tous les journaux télévisés : le problème numéro un pour l’emploi aujourd’hui, c’est l’inadéquation offre-demande. Il y a 20 ans, quand j’étais à Sciences-Po, il y avait un critère prioritaire qui dictait le choix des entreprises dans lesquelles on allait vouloir travailler : le salaire. Vous allez aujourd’hui à la sortie des grandes écoles, les étudiants vous diront avoir fait un arbitrage : ils ont compris qu’il fallait un salaire pour vivre, mais ils veulent également donner un sens et quelque part « un sens moral » à leur action. Je vous invite à cet égard à consulter le Manifeste étudiant pour un réveil écologique. C’est devenu structurel depuis une dizaine d’années, les études sociologiques le démontrent. C’est pourquoi j’ai énormément confiance dans la génération qui vient. Si l’on ne partage pas le pouvoir, si l’on ne partage pas la valeur dans une entreprise, ladite entreprise souffrira d’une pénurie de ces fameux « talents ». Les jeunes diplômés ne viendront pas. S’ils n’ont pas leur mot à dire, s’ils ne sont pas a minima informés de façon transparente sur l’impact de leur employeur, ils ne viendront pas. C’est un enjeu d’attractivité pour les entreprises, c’est donc fondamentalement un enjeu de compétitivité.
— À vous entendre, on se dit que l’avenir appartient à l’économie sociale et solidaire, car justement, elle est réellement porteuse de sens, non ?
OG: L’économie sociale et solidaire, c’est le sens de l’histoire. Elle a un savoir-faire depuis des décennies qu’on retrouve dans le modèle mutualiste ou dans le modèle coopératif. Je pense que cette économie a beaucoup à apprendre aux acteurs traditionnels de l’économie. Mais l’économie sociale et solidaire peut et doit se renforcer. Cette économie mérite qu’on la prenne au sérieux, elle mérite que l’on y investisse. C’est pour favoriser la coopération que j’ai relancé les PTCE (Pôles territoriaux de coopération économique). Benoît Hamon avait initié en 2015 ces regroupements d’acteurs de l’économie sociale et solidaire et d’entreprises sur les territoires. Cela faisait 5 ans que ces pôles n’étaient plus financés par l’État. J’ai mis 2,5 millions d’euros par an pour les relancer, consolider ceux qui existent, et en faire émerger de nouveaux. Ainsi, 4 ou 5 structures, issues de l’ESS ou non, se réunissent et constituent une force de frappe importante sur le territoire, capables de lever des fonds, de recruter ensemble et de s’organiser autour de projets économiques pour se développer davantage. Cet encouragement, non pas à la fusion mais au regroupement, pour avoir plus de force, est très pratiqué dans le privé classique, je l’insuffle dans l’ESS grâce aux PTCE.C’est pour favoriser un meilleur financement de l’ESS que j’ai lancé les contrats à impact, avec un investissement à hauteur de 50 millions d’euros, ce qui représente une part massive du budget de mon secrétariat d’État. Ces contrats, nés il y a 10 ans en Angleterre, permettent un partenariat entre le public et le privé destiné à favoriser l’émergence de projets sociaux et environnementaux innovants. Ces contrats visent le changement d’échelle de solutions identifiées sur le terrain et efficaces. L’investisseur privé préfinance le projet et prend le risque de l’échec en échange d’une rémunération prévue d’avance en cas de succès. L’État ne rembourse qu’en fonction des résultats effectivement obtenus et constatés objectivement par un évaluateur indépendant.
— Les contrats à impact, c’est un peu une délégation de service public ?
OG : Je ne le formulerais pas ainsi. C’est surtout permettre de faire passer du local au national des solutions qui ont fait leurs preuves grâce à un investissement en confiance : quand le projet réussit, l’État supporte 100% de l’investissement et rembourse l’investisseur. L’État sait évaluer : c’est pour cela que, depuis que je suis arrivée, j’ai professionnalisé l’évaluation des contrats impacts. J’ai confié à Thomas Cazenave, inspecteur général des finances, une mission sur la massification des contrats à impact. C’est de l’innovation politique, c’est une nouvelle façon de pratiquer. Il y a quand même des valeurs morales extrêmement fortes dans cette économie : je pense évidemment aux associations, dont on ne peut que saluer l’engagement en première ligne de la crise sanitaire. C’est sur ce message d’espoir aux associations et acteurs de l’ESS que j’aimerais conclure : croyez en vous autant que moi je crois en vous. Parce que vous représentez aujourd’hui 10% du PIB et entre 10 et 15% de l’emploi salarié. Compte tenu de ce que l’on s’est dit sur les jeunes, de leurs attentes, de la mutation du capitalisme vers un capitalisme citoyen, cette économie sociale pourrait représenter 20 ou 25% de notre PIB à l’avenir.
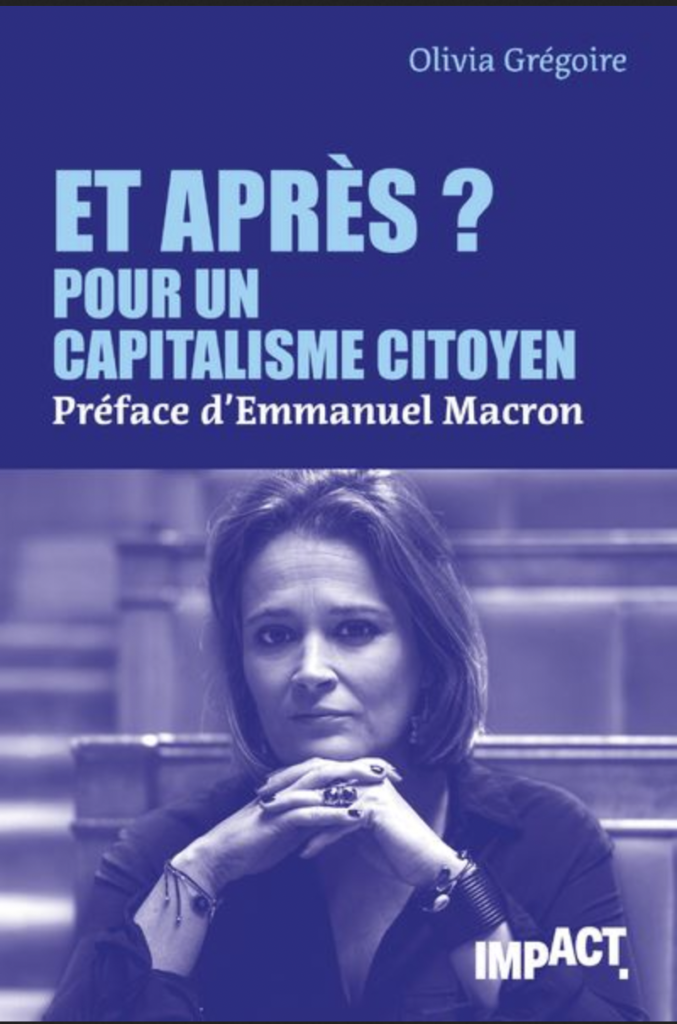
Service
Service
Service
Service
Service
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d’information de la société Innomédias. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la lettre d’information.
En savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et vos droits.
Le média des idées et des innovations qui transforment les territoires